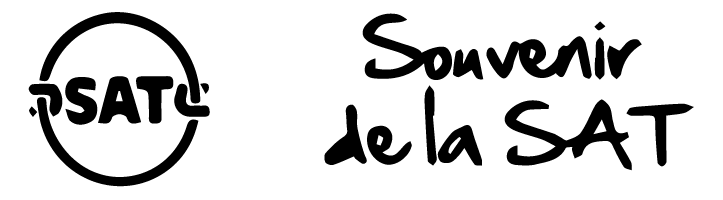
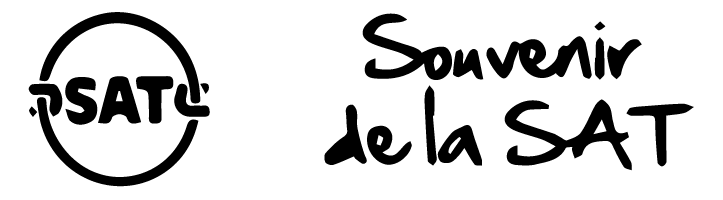
L’organisation, la communication interne et le climat social à la SAT
1 – INTRODUCTION
Il en va des entreprises, industrielles notamment, comme de certaines rivières : elles ont un cours visible, inscrit sur les cartes, et un autre souterrain, échappant aux regards, et cependant essentiel quant à la régulation du cours d’eau. Cela pouvait particulièrement se vérifier à la SAT qui était l’entreprise industrielle la plus importante du 13e arrondissement de PARIS, avant qu’elle ne disparaisse. Entreprise où, le turn-over étant très faible, des contacts transversaux entre salariés pouvaient s’établir et perdurer.
Je peux, bien sûr, ne faire part que de ma propre expérience fondée sur plus de deux décennies d’activité au sein de la SAT. Il ne s’agit pas de parler d’un parcours rempli d’anecdotes, mais d’essayer de montrer que les communications transversales entre salarié(e)s de divers services et les formes d’organisation du travail non-hiérarchiques qu’elles entraînaient ont aussi joué leurs rôles quant au développement de la saga technique et industrielle de la SAT.
Cette communication et organisation du travail, non-officielle et non-pyramidale, à l’opposé donc d’une démarche autoritaire – la discipline est peut-être la force des armées, pas celle, je crois, d’ouvrières et d’ouvriers qualifiés, de techniciens et d’ingénieurs – était aussi génératrice de rapports humains n’ayant aucun lien avec les objectifs industriels : culture, acquisition de connaissances, loisirs, etc… Rapports humains cependant essentiels à la bonne marche d’une entreprise.
2 – La « Section 6 » et « mai 68 »
Je suis entré à la SAT fin 1967, à la Section 6. Le cœur de ce service était constitué de préparateurs de fabrication. Ils servaient essentiellement d’interface entre les ateliers ou entreprises sous-traitantes, chargés de réaliser ce qui était conçu dans les laboratoires et services techniques (dessinateurs industriels). Faisaient également partie de cette Section 6, un atelier de câblage, un atelier de mécanique et un autre de tôlerie, plus quelques services annexes. L’ensemble représentait plus de 300 personnes, je crois.
J’étais donc là en mai 68 et fût, je m’en souviens, de manière bizarre (mais non-innocente) l’élément déclencheur de la grève dans ce service. Il avait suffit, constatant qu’à côté de nous un petit bureau d’études s’était mis en grève, de poser cette question : « et nous, qu’est-ce qu’on fait ? ». Il faut dire que les préparateurs de fabrication étaient tous d’anciens ouvriers professionnels, que les ateliers de mécanique et de tôlerie (les ateliers « rouges ») étaient déjà en grève.
Je me souviens encore que la grève à Section 6 avait duré, jusqu’aux « Accords de Grenelle » (la victoire, non ?), bloquant pendant cette période le travail de ceux qui, dans les labos et services techniques, n’étaient pas en grève. Ceux-ci étaient logés, comme nous au 41 de la rue Cantagrel, mais quelques étages au-dessus.
Je me souviens qu’après la reprise du travail d’intenses discussions eurent lieu entre salariés de tous les services. Au cours de l’une des réunions, je ne sais plus ni où ni comment, je lançais l’idée (peut-être ne fus-je pas le seul ?) du droit des salariés à comprendre le pourquoi et le comment des techniques que les uns et les autres (il s’agissait surtout des techniciens) mettaient en œuvre.
La CFDT, je crois, se saisit de cette revendication que la Direction accepta. Résultats : pendant quelques mois, des dizaines de conférences (conduites par des ingénieurs, qui dans leur grande majorité n’avaient pas fait grève) eurent lieu auxquels participèrent des centaines de salariés qui, eux, pour une bonne part avaient fait grève.
Ceci pour dire qu’une communication pas vraiment hiérarchique était possible et pouvait générer d’autres rapports productifs entre salariés que ceux traditionnels. Cette expérience ne fut cependant qu’un feu de paille.
3 – De la division du travail et de ses effets contre-productifs
J’avais donc été « embauché » à la Section 6 comme préparateur de fabrication. Les dossiers descendaient des labos et services techniques, suivaient la voie hiérarchique et, après avoir été triés (la plupart des dossiers contenaient à la fois des éléments mécaniques et électroniques), aboutissaient aux préparateurs spécialisés (mécanique ou électronique) et, pour ce qui concernait de simples achats de composants à des acheteuses ou acheteurs. Les préparateurs avaient chacun pour mission de traiter les dossiers qui leurs parvenaient, c’est-à-dire de faire se matérialiser plans et schémas dans les ateliers de la SAT ou chez des sous-traitants.
J’avais été recruté comme préparateur chargé de traiter des dossiers électroniques (j’avais un diplôme de technicien en hyperfréquences) et, manque de chance, à cette époque il n’y avait que des liasses de plans mécaniques qui arrivaient. Après une période de mise au courant, sans dossiers à traiter je commençais à trouver le temps long. Je m’en ouvris à mon supérieur (M. FELIX) et, voyant que la pile de dossiers montait de jour en jour, lui dit que je pouvais aussi m’occuper des dossiers « mécaniques ». J’avais, en effet, un diplôme de préparateur en fabrication mécanique. Ce qui fut fait, et se sut dans les labos et les services techniques.
Dès ce moment-là, le travail afflua. Beaucoup d’ingénieurs et techniciens souhaitaient que je traite leurs affaires. Avantages pour eux : un seul interlocuteur, pas de découpage de dossier et, surtout, une meilleure cohérence dans les délais de fabrication. Bref, la petite réduction dans la division du travail conduisait à moins de bureaucratie et à une efficacité sensiblement accrue, me semble-t-il.
Finalement, je ne me souviens plus comment cela se fit, je fus affecté, comme préparateur, à un important labo : celui de M. ISRAEL et au service technique correspondant : celui de M. DURET. Ainsi se mit en place une organisation du travail où ingénieurs et techniciens me donnaient directement les dossiers complets à traiter, sans suivre la voie hiérarchique traditionnelle. Tout se passait comme si je ne faisais plus vraiment partie de la Section 6. J’étais devenu un travailleur indépendant au service du labo de M. ISRAEL et du service technique correspondant.
Cette situation avait quand même un inconvénient : mon chef direct (M. SCHNEIDER) ne savait plus ce que je faisais, sauf que je travaillais. Ce qui avait une conséquence fâcheuse : il ne demandait plus, le moment venu, d’augmentation personnelle de salaire me concernant. Le remède fut trouvé sous une forme, là encore hors système hiérarchique : un ingénieur du labo intervenait, de temps en temps, auprès de M. BOUCHER, le responsable de la Section 6 qui avait rang de sous-directeur, et j’avais ma « rallonge » !
Mon intégration, en quelque sorte, au labo de M. ISRAEL devint encore plus effective avec l’introduction d’une gestion informatisée des commandes propre à ce labo, c’était alors le seul à aller dans cette voie. Il faut savoir que les différentes équipes de ce labo utilisaient la plupart du temps des composants identiques entrant dans des matériels différents et à des dates également différentes. Jusque-là, chaque équipe gérait son stock de composants de manière un peu archaïque. Cela prenait de la place et du temps et n’était pas très rationnel. L’idée fut, je crois qu’elle était de M. ISRAEL, de regrouper matériellement le stock de composants dans un même lieu (c’était en Section 6), de gérer les commandes et leurs délais, les entrées et les sorties de manière informatisée. Cela concernait des milliers de composants.
Ainsi fut-il fait. Il y avait quand même quelques problèmes : il fallait inventer et écrire le programme informatique, et le tester avant de le mettre en œuvre. Il faut dire que je n’entendais alors rien à la programmation informatique. J’appris donc le Fortran, sur le tas comme on dit, avec l’aide d’ingénieurs du labo et d’un service informatique spécialisé de la SAT : celui de Mlle LAFERRIERE. Il faut dire encore que l’informatique d’alors fonctionnait avec des cartes perforées, qu’il fallait donc remplir des bordereaux et perforer autant de cartes qu’il y avait de variétés de composants. Ce système fonctionna, je crois, quelques années.
4 – Le réseau AIR 70 : savoir et comprendre
Le marché du réseau AIR 70 fut un grand moment à la SAT. Il s’agissait d’un système de télécommunications reliant les différentes bases militaires aériennes Françaises. L’originalité de ce réseau était liée à son mode de fonctionnement. Il ne fonctionnait pas de manière hiérarchique classique, avec un commutateur central dispatchant les communications téléphoniques vers les diverses bases militaires aériennes, mais avec un système original où les communications circulaient en réseau, chaque base aérienne disposant de son propre autocommutateur, sans existence donc d’un commutateur central.
L’avantage d’une telle nouvelle configuration était, vu du côté des militaires, qu’une base pouvait être détruite sans pour autant altérer ou empêcher les communications entre les autres bases aériennes. Ce réseau des années 70 préfigurait en quelque sorte ce qu’ont été par la suite les centraux téléphoniques électroniques à autonomie d’acheminement du Service Public (sans pour autant que la SAT eut accès à ce marché) et, même, les principes qui commandèrent plus tard le fonctionnement d’Internet.
Je suis bien incapable de décrire cette saga technique et industrielle à la SAT. Des dizaines et des dizaines de techniciens et d’ingénieurs, d’informaticiens, de câbleuses et d’ouvriers professionnels ont participé à l’étude du réseau AIR 70, à sa mise au point permettant sa réalisation industrielle. Cela se fit dans les établissements de Paris, la fabrication industrielle étant, elle, pour une bonne part, réalisée dans celui de Dourdan.
J’étais, en Section 6, le seul préparateur travaillant sur ce réseau AIR 70, c’est-à-dire que j’étais chargé de faire réaliser matériellement, aux diverses étapes d’avancement des études, les dossiers techniques d’un prototype. Cela représenta beaucoup de travail et aurait été beaucoup plus difficile, pour tous ceux qui participaient au projet, sans la gestion informatisée des commandes et de leur suivie qui avait été mis en place.
Quand le prototype de commutateur fut réalisé, testé et mis en fonctionnement (cela se passait dans un sous-sol du 41 rue Cantagrel) il y eut, je crois, une petite fête, un « pot ». Ce qui était assez courant au labo et témoignait de l’ambiance humaine et conviviale qui y régnait. En dehors de ceux qui travaillaient directement sur le projet, des dizaines d’autres personnes y avaient participé, directement ou indirectement, en avaient entendu parler et, visiblement, étaient curieux de savoir de quoi il s’agissait.
C’est alors qu’une idée me vint : puisque le « proto » était là, au sous-sol, n’était-il pas possible de le montrer à toutes ces personnes et de leur en expliquer le fonctionnement. Je m’en ouvris à M. MUSLEWSKI, ingénieur important (il était aussi de grande taille) du labo et en charge de ce « proto ». L’idée fut acceptée. Cela nécessita toute une organisation : en effet, pendant deux jours, je crois, des groupes de divers services, d’une dizaine de personnes à chaque fois, vinrent au local un peu exigu du sous-sol, voir bien sûr le proto, mais surtout entendre M. MUSLEWSKI donner des explications sur les principes de fonctionnement de ce commutateur révolutionnaire. Cerise sur le gâteau, l’interactivité existait aussi : les visiteurs avaient tout loisir de poser des questions, et il y en eut beaucoup.
Si ce réseau AIR 70 fut avant tout, un grand moment technique à la SAT, et un grand marché, il fut aussi, par ces « visites organisées », une expérience de communication humaine peu commune dans l’entreprise. Je ne sache pas qu’il y en eut de similaires à la SAT.
5 – Faire travailler les ateliers de la SAT… ou sous-traiter ?
Je me souviens, c’était plus tard, la « crise » pointait dans le pays… et à la SAT. Jusque-là, à chaque marché d’étude (qui était généralement d’État, principal client de l’entreprise) devait correspondre un nombre d’heures travaillées : heures d’ingénieurs, de techniciens et d’ouvriers, etc. Ce qui correspondait à un nombre de personnes mobilisées sur chaque étude (quand il s’agissait d’études) et permettait ainsi de justifier le montant des marchés aux yeux des administrations passeuses d’ordres. Ceux-ci étant généralement confortables – c’était les 30 glorieuses – et fixés avant réalisation de l’étude, les effectifs de la SAT avaient eut tendance à être, eux-aussi, confortables.
Avec le début de la « crise », les administrations devinrent plus tatillonnent et les marchés d’études plus serrés. Cela conduisit dans l’entreprise à des remises en causes : ré-études de postes et recentrage des activités de la SAT sur l’essentiel.
Les préparateurs de fabrication de la Section 6 avaient donc pour fonction de servir d’interface entre les labos et les services techniques pour la réalisation des maquettes, prototypes et préséries. À ce titre, ils avaient une relative liberté de choix, pour ce qui concernait la mécanique et l’électronique, de faire réaliser les matériels soit à la SAT, soit chez des sous-traitants. Personnellement, j’avais donc comme particularité à la Section 6 de traiter à la fois les dossiers mécaniques et électroniques.
Un jour, le responsable du service – M. BOUCHER, qui avait rang de sous-directeur - me prit à part et me demanda de privilégier la sous-traitance. Ce n’était pas vraiment un ordre mais plutôt une suggestion qui devait émaner de « plus haut ». Ce qui était visé essentiellement, me semble-t-il, c’était à terme la disparition des ateliers de mécanique et de tôlerie. Les chefs d’atelier en question en avaient conscience, il leur suffisait de constater l’arrêt des embauches et le non-renouvellement des départs en retraite.
Pour ma part, je pris le parti de privilégier, puisque ce n’était pas vraiment un ordre, la réalisation du travail à la SAT. Je me souviens d’un contrat implicite qui s’instaura entre les chefs d’atelier (MM. GUINGEL, BROSSIER et DUMESNIL) et moi pour fabriquer à la SAT, chaque fois que c’était possible, les matériels dont j’avais la charge. Seules conditions imposées : la tenue des délais et la qualité (mais pour ce dernier point, il y avait rarement des problèmes). Ces conditions étaient d’autant plus faciles à remplir étant donné ma proximité avec les ouvriers de ces ateliers. Ateliers « rouges » qui, dans les établissements de Paris, étaient ceux les plus souvent en grève (quand il y avait appel à la grève). Et, généralement, j’étais solidaire et participait avec eux aux défilés, quand il y en avait. Ce parti pris de faire réaliser à la SAT ce dont j’avais la charge dura jusqu’à mon départ de la Section 6 pour « Les câbles ».
6 – « Les câbles » : la Pologne.
Réorganisation. Le labo de M. ISRAEL et les services techniques correspondant déménagèrent à l’établissement de DOURDAN, pour des raisons d’espace je crois. On me proposa de suivre pour animer là-bas une antenne de la Section 6. Je refusai. Je venais d’acheter un pavillon en Seine-et-Marne et de m’y installer. Je n’avais pas du tout envie de recommencer, ma femme encore moins.
Après avoir contribué à la mise en route de cette antenne, je me retrouvais, en quelque sorte, sans travail. J’aurais pu être « recasé » en Section 6 à PARIS, c’était apparemment le vœu de mon chef direct : M. SCHNEIDER. Il rêvait d’une informatisation de ce service et me voyait y jouant un rôle. Cela contribua, je crois, au choix, à l’échelon supérieur, de me faire quitter la Section 6. Je partis donc aux « Câbles ».
Aux « Machines câbles », plus précisément (dirigés alors par M. ALLANIC) où j’avais à peu près les mêmes fonctions qu’en Section 6 : essentiellement faire réaliser (il ne s’agissait que de mécanique) les plans sortant d’un bureau d’étude, dirigé lui par M. GUILLON. J’étais intégré à ce bureau d’études. Les « Câbles » étaient une division importante de la SAT : 1/3 du chiffre d’affaires et 1/3 environ du personnel, autant que je m’en souvienne. Cela comprenait une câblerie installée à RIOM, des équipes chargées d’installer les lignes téléphoniques (les « Chantiers »), des bureaux d’études, des services commerciaux, etc. Les « Câbles » étaient dirigés par un personnage important et fascinant, d’origine russe : M. FUCHS.
Mon arrivée aux « Machines câbles » était justifiée par un très gros marché : la construction et l’installation d’une câblerie (la plus grosse alors d’Europe) en Pologne et le départ d’un certain nombre de personnes de ce service pour ce pays. L’essentiel des travaux de ce bureau d’études était, bien sûr, consacré à ce marché. Il s’agissait de la réalisation des machines et de leurs mises au point. Tous les plans qui sortaient du bureau d’études étaient sous-traités. Cela était logique pour les machines qui pour la plupart étaient très grosses. Des sous-traitants sélectionnés étaient mis chaque fois en concurrence et le marché était remporté par l’entreprise proposant le meilleur prix, compte tenu des délais.
Avant, et parallèlement, au lancement en fabrication de ces machines, il y avait une autre sous-traitance. Elle concernait des pièces plus petites, ou de petites machines, mais dont les délais étaient très urgents, puisqu’il s’agissait de vérifier la faisabilité de ce qui était en cours d’études. Au début j’ai proposé de faire réaliser ces pièces dans les ateliers mécaniques de la SAT, ce qui était possible. Mais dans l’entreprise il y avait des barrières infranchissables entre services et personne aux « Câbles » ne connaissait ces ateliers pourtant voisins. Les grosses machines et les petites pièces urgentes continuèrent donc à être sous-traitées.
S’agissant des petites pièces (il y en eut beaucoup et cela représenta des sommes importantes), c’était toujours très urgent. Il n’y avait donc pas de mise en concurrence, et les patrons des petites entreprises qui les fabriquaient venaient souvent chercher les plans le matin pour parfois devoir livrer les pièces le lendemain. Ceci sans commande écrite et signée. Il faut rappeler que le système hiérarchique classique réclamait qu’une commande, pour être régulière et conforme aux normes, soit signée par l’un des chefs de service. Il se trouvait que ceux-ci étaient souvent absents, ou arrivaient au bureau quand les petits patrons étaient déjà repartis avec les plans, et que le cérémonial de la dactylographie et de la signature de la commande prenait nécessairement du temps, ce qui est le propre de toute bureaucratie.
Il n’était pourtant pas normal et encore moins logique que des sous-traitants travaillent sans ordre écrit, ne serait-ce que pour pouvoir assurer le suivi et la fixation du délai. J’inventai donc un système de « pré-commandes ». Elles étaient manuelles et je les signais. C’était du vent, mais les sous-traitants se sentaient rassurés. Les commandes officielles parvenaient plus tard, sous forme de régularisation. Cela se faisait avec l’aval de M. ALLANIC, et peut-être de M. FUCHS, bien que parfois remis en cause par certains (je n’avais pas le droit de signer, n’est-ce pas ?), mais jamais aboli. Sauf quand le service fût dissous.
7 – « Les câbles » : du Guide d’ondes aux Fibres optiques
L’installation de la câblerie construite par la SAT en Pologne se terminait. Un jour, j’étais à RIOM pour surveiller le chargement et l’expédition par camions des dernières machines. Tout le matériel en partance était en effet regroupé là, à la câblerie.
Il se trouvait, par ailleurs, que la SAT avait obtenu un important marché d’études du CNET à propos de transmissions téléphoniques par guides d’ondes et que l’atelier où étaient réalisés les essais et mises au point se trouvait également à l’usine de RIOM. Ce procédé de transmissions téléphoniques était concurrent à un autre : celui par fibres optiques ; marché d’études que des entreprises concurrentes de la SAT avaient obtenu.
J’étais donc à RIOM pour le départ des machines en Pologne, ce qui n’avait rien à voir avec les guides d’ondes, et ce jour-là, avait lieu une réunion entre les responsables du projet de liaisons téléphoniques par guide d’ondes, ceux du CNET et ceux de la SAT. A midi, je me souviens, nous sommes partis au restaurant pour le déjeuner. Se trouvaient dans la voiture : MM. FUCHS, ALLANIC et moi-même. C’est là, dans la voiture, que j’entendis le premier s’adresser, avec son accent russe, au second à peu près en ces termes : « Je crois que nous nous sommes trompés. L’avenir, ce n’est pas le guide d’ondes, ce sont les fibres optiques. Il va falloir s’y lancer à fond ». M. ALLANIC resta abasourdi.
Les travaux sur les guides d’ondes continuèrent cependant. Les derniers fignolages eurent lieu. Les essais de transmission en direct furent réalisés à LANNION, en boucle sur plusieurs kilomètres. Essais couronnés de succès… et sans suite. Le marché d’études fut prorogé de six mois par le CNET, le temps de démonter l’atelier qui n’avait plus de raison d’être et de trouver de nouveaux postes pour ceux qui travaillaient sur le projet.
Les « Machines câbles » et le bureau d’études se lancèrent alors à fond sur les « fibres optiques ». Vinrent en renfort ceux qui rentraient de Pologne, notamment M. DELEBECQUE. Deux machines au cœur du procédé furent mises au point en un temps record : l’extrudeuse qui produisait la fibre optique et l’assembleuse qui sortait en faisceaux les kilomètres de fibres optiques. Toutes deux, mais surtout la première, utilisaient des procédés originaux. Heureusement que le système des « pré-commandes » au cours de ces mises au point continua, après le marché de la Pologne, à fonctionner à plein : c’était, je crois, une condition pour arriver très rapidement aux résultats.
La suite n’est pas drôle. La SAT n’avait pas déposé de brevets pour les procédés originaux qu’elles mettaient en œuvre dans ces machines. Autant que je m’en souvienne, le budget de la SAT relatif aux dépôts de brevets était, pour cette année-là, épuisé. Résultat : un concurrent, « Les Câbles de LYON » avaient, après la SAT, mis au point des procédés similaires… et déposé des brevets. Ainsi, la SAT, si elle continuait à fabriquer des câbles à fibres optiques, devait, pour chaque kilomètre de câble réalisé, payer des royalties aux Câbles de LYON.
Il y eut cependant quelques réalisations spectaculaires : en 1980, pour la première fois au monde, la SAT fut retenue comme maître d’œuvre pour réaliser à BIARRITZ un réseau commuté sur fibre optique. Ce réseau permettait de fournir aux abonnés sur une seule liaison une gamme complète de services : téléphone, télévision, Minitel… En 1986, la SAT fut retenue pour réaliser aux Etats-Unis un réseau interurbain en fibre optique fonctionnant à 560 Mbits/s.
Tout fut pourtant réglé un peu plus tard, de manière radicale. La SAT racheta une grosse entreprise : SILEC, spécialisée dans la signalisation et la production de câbles téléphoniques, notamment des fibres optiques pour lesquels elle avait ses propres brevets. Cela signifia, nous en étions conscients, la fin des « Machines câbles » et du bureau d’études. Ce qui fut effectif quelques mois plus tard. Le service fut dissous. Plus tard, la câblerie de RIOM fut fermée, compétitivité oblige disait un jugement (318 licenciements). Ensuite, la SAT devint filiale de la SAGEM pour finalement être intégrée à cette entreprise.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o